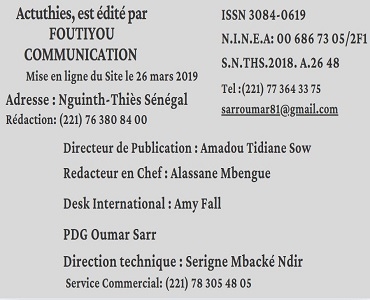une rupture géopolitique et une ambition de souveraineté active
Par René Rotsh-Kitoko, journaliste et essayiste
L’AES : une boussole souverainiste pour l’Afrique en recomposition
 Dans un contexte de recomposition géopolitique accélérée, l’Alliance des États du Sahel (AES) s’impose comme un marqueur fort de la volonté de rupture avec les logiques néocoloniales et les dépendances structurelles qui entravent l’émancipation africaine. Loin d’être une simple coalition militaire, l’AES incarne une dynamique de refondation politique, économique et symbolique. Elle redonne sens à la souveraineté africaine, non comme slogan, mais comme praxis.
Dans un contexte de recomposition géopolitique accélérée, l’Alliance des États du Sahel (AES) s’impose comme un marqueur fort de la volonté de rupture avec les logiques néocoloniales et les dépendances structurelles qui entravent l’émancipation africaine. Loin d’être une simple coalition militaire, l’AES incarne une dynamique de refondation politique, économique et symbolique. Elle redonne sens à la souveraineté africaine, non comme slogan, mais comme praxis.
Une souveraineté politique réaffirmée:
L’AES naît dans un moment de basculement : celui où des États, longtemps soumis aux injonctions extérieures, décident de reprendre la maîtrise de leur destin. En se retirant de la CEDEAO, perçue comme trop alignée sur les intérêts occidentaux, le Mali, le Burkina Faso et le Niger affirment une volonté de redéfinir les règles du jeu régional. Cette décision, certes radicale, traduit une exigence de cohérence entre les aspirations populaires et les choix institutionnels.
L’AES devient ainsi un espace de réinvention politique : elle permet de penser des modèles de gouvernance enracinés, adaptés aux réalités locales, libérés des tutelles diplomatiques et des conditionnalités imposées par les bailleurs. Une ambition économique de rupture
sur le plan économique, l’AES propose une alternative à l’économie de rente et à la dépendance monétaire. En envisageant la création d’une monnaie propre, elle remet en question le système du franc CFA, symbole d’une souveraineté confisquée. Elle ouvre la voie à une économie de coopération régionale, fondée sur la complémentarité des ressources, la valorisation des chaînes locales et la réduction des dépendances commerciales.
Cette ambition économique n’est pas sans risques : enclavement, manque d’infrastructures, pression des marchés extérieurs. Mais elle offre une opportunité historique de repenser les modèles de développement, en misant sur l’endogénéité, la résilience et l’innovation territoriale.
Conséquences géopolitiques : entre isolement et recomposition:
L’AES bouscule les équilibres régionaux. Elle provoque des tensions avec la CEDEAO, l’Union africaine et les partenaires occidentaux. Elle suscite des sanctions, des ruptures diplomatiques, des campagnes de dénigrement. Mais elle oblige aussi les institutions africaines à se repositionner, à écouter les peuples, à réinterroger leurs propres légitimités. Loin d’un isolement, l’AES pourrait devenir un pôle d’attraction pour d’autres États en quête de souveraineté. Elle préfigure une Afrique plurielle, capable de penser ses alliances en fonction de ses intérêts, et non de ses dépendances. Une pédagogie citoyenne de la souveraineté.
L’AES ne se limite pas aux chancelleries. Elle réactive les imaginaires populaires : dignité, résistance, refondation. Elle redonne sens à la parole citoyenne, à la mobilisation sociale, à la critique des modèles imposés. Elle invite les intellectuels, les artistes, les enseignants à penser une souveraineté active, créative, inclusive. C’est là que réside sa force : dans sa capacité à devenir un projet de société, un levier de transformation, un outil de conscientisation.
L’AES n’est pas une fin en soi. Elle est un début. Un espace à structurer, à démocratiser, à élargir. Elle pose les bases d’une souveraineté africaine repensée, non comme repli, mais comme ouverture maîtrisée. Elle invite à construire des institutions. D'où l'intérêt pour les autres Etats de rejoindre l’AES pour la refondation d’une Africaine participative et souveraine.

Redaction
Rrk
canaf54.mag@gmail.com
Le Partage de l'info



 Kaw Oumar Sarr
Kaw Oumar Sarr